31 mars 2025
 5 min
5 min

Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


25 mars 2025
Intoxication canine par le raisin en France : atteinte rénale rare, mais à pronostic sombre

Depuis la fin des années 1990, la littérature fait état d'un lien potentiel entre l'ingestion de raisin, fruit de la vigne (Vitis), ou ses dérivés secs, et l'apparition d'atteintes rénales aiguës parfois mortelles chez le chien. Une thèse vétérinaire récente décrit l'épidémiologie et l'incidence des signes cliniques de cas français, à partir des données du Centre Anti-Poison Animal et Environnemental de l'Ouest (CAPAE-Ouest) et du Centre National d'Informations Toxicologiques Vétérinaires (CNITV), sur 18 mois d'appels.
Les principaux éléments chimiques composant la pulpe des baies sont l'eau, les glucides et les acides organiques : l'acide tartrique, l'acide malique et, plus anecdotiquement, l'acide citrique. La concentration en acide tartrique dépend les variétés, du stade de maturité et de la saison. Les produits à l'origine d'intoxication chez les carnivores domestiques sont le raisin frais, les raisins secs, le marc de raisin (exploitations viticoles) ou encore les engrais organiques azotés dont la source d'azote est le raisin (ou son moût). En revanche, les jus, le vin ou encore les confitures ne seraient pas toxiques, probablement grâce aux processus de… détartrage (réduction de l'acide tartrique).
Si le mécanisme de la toxicité de l'acide tartrique n'est pas connu avec certitude, l'hypothèse prévalant actuellement est qu'il s'accumulerait dans les cellules de la paroi du tubule proximal rénal, en étant absorbé depuis les capillaires péritubulaires via un transporteur actif (OAT1, voir le schéma ci-dessous). Chez les humains, il est ensuite excrété vers la lumière des tubules proximaux, et donc vers l'urine, par un autre transporteur, OAT4. Mais ce transporteur fait défaut à l'espèce canine… d'où l'accumulation intracellulaire et la toxicité rénale. De fait, les lésions observées lors de ces intoxications sont une nécrose et une dégénérescence des cellules tubulaires. Toutefois, l'intégrité de la membrane basale est préservée. Le tableau clinique lors d'intoxication au raisin se décline en 3 volets : digestif, rénal et, plus anecdotiquement, nerveux – parfois avec une atteinte peu spécifique de l'état général de l'animal (abattement, ou déshydratation). Les signes observés lors d'une atteinte rénale aiguë apparaissent dans les 24 à 72 heures suivant l'ingestion.
Schéma de l'accumulation d'acide tartrique dans les cellules tubulaires proximales (en bleu). L. Tessier, 2024.
Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023, 634 cas mentionnant le toxique « raisin » ont été reçus par les deux centres ayant partagé leurs données. Cela représente 0,7 % de tous les appels – dont 339 ont été retenus (317 chiens et 22 chats). Les données montrent un pic d'incidence des cas d'août à novembre. Un peu plus d'un chien sur cinq (22 %) a présenté des signes cliniques. Les signes les plus fréquents sont des vomissements (37/71) ou de la diarrhée (28/71). La thèse souligne qu'il « est fortement probable que des vomissements spontanés précoces empêchent la résorption des toxiques contenus dans le raisin, et protègent d'une atteinte rénale aiguë potentielle ». Six cas d'atteinte rénale aiguë ont été retenus (8,4 % des cas symptomatiques), tous de grade supérieur ou égal à 3 dans la classification IRIS. Ils ont eu une issue fatale dans la moitié des cas (3/6) : 2 décès et 1 euthanasie. C'est conforme avec la littérature, qui fait état d'un pronostic favorable lorsque la symptomatologie est absente ou strictement digestive. En revanche, si une atteinte rénale aiguë est installée, le pronostic est bien plus réservé, avec des taux de mortalité allant chez le chien de 34 % à 60 % selon les références. Les signes cliniques nerveux seraient de bon pronostic car réversibles et a priori non liés à l'urémie.
Une surreprésentation statistique des chiens et des chats de moins d'un an a été mise en évidence en comparaison avec la population générale : ils représentent plus du quart (26,7 %) des cas. L'ingestion est le plus souvent accidentelle, soit au sein du foyer (fruits frais ou secs et préparations cuisinées en contenant) ou lors de promenades en extérieur. Dans ce cas, il s'agit plutôt des engrais organiques azotés, de marc ou encore de grappes de fruits frais sur pied. Il existe également des cas d'intoxication par méconnaissance du propriétaire, ce dernier donnant à son animal du raisin en récompense ou friandise. Selon les données de la thèse, le raisin ingéré l'a été plus fréquemment sous la forme de raisin frais (243/317) que de raisin sec (74/317). Un seul chien a ingéré des déchets de pressage (marc), quand 5 ont ingéré des gâteaux ou viennoiseries contenant des raisins secs.
Aux urgences, il convient d'abord d'éliminer le toxique en administrant une molécule émétisante (apomorphine, 0,1 mg/kg SC ou peroxyde d'hydrogène 3 % à 2 ml/kg PO), ce qui reste efficace jusqu'à environ 12 heures post-ingestion. Ensuite, une administration orale de charbon végétal actif (1 à 5 g/kg) pourra être réalisée toutes les 4 à 6 heures pendant 24 à 48 heures. Elle peut permettre de prévenir l'absorption du toxique, mais n'a aucune efficacité avérée sur la toxicité du raisin (il n'y a d'ailleurs pas d'antidote à l'accumulation d'acide tartrique). Enfin, une fluidothérapie sera instaurée pendant environ 48 heures, permettant le maintien du débit de filtration glomérulaire, et donc de prévenir l'atteinte rénale aiguë. N'existant pas d'antidote, un traitement symptomatique sera ensuite mis en place en cas de signes cliniques et/ou des modifications biologiques.
31 mars 2025
 5 min
5 min

28 mars 2025
 4 min
4 min

27 mars 2025
 4 min
4 min
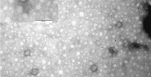
26 mars 2025
 4 min
4 min

24 mars 2025
 6 min
6 min
