28 avril 2025
 4 min
4 min
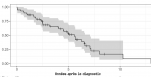
Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


Une étude rétrospective sur 43 cas de fractures du bassin chez des chats, dont 32 (74 %) stabilisés par chirurgie, montre que le pronostic à long terme est « excellent », le plus souvent sans aucune séquelle.
Chat accidenté : quel est le pronostic d’une fracture pelvienne ? Plutôt très bon, d’après une étude rétrospective sur 43 cas, publiée par le Journal of Feline Medicine and Surgery (article en ligne le 7 octobre dernier).
Dans cette étude, trois quarts des chats ont été opérés ; les autres ont subi un traitement conservateur. D’après leur suivi à long terme (2 ans en moyenne, 6 mois au minimum), les séquelles sont rares dans tous les cas.
Les fractures du bassin représenteraient jusqu’à un tiers des fractures chez le chat, touchant le plus souvent le plancher pelvien. La chirurgie n’est pas systématiquement indiquée. D’autres lésions sont souvent associées aux fractures osseuses : atteintes urinaires, déficits neurologiques.
Parmi les 43 cas inclus dans l’étude, 40 présentaient des fractures/luxations multiples, d’où l’importance d’une observation minutieuse des radiographies afin de compléter le bilan lésionnel :
Environ un quart des chats (11, soit 26 %) ont reçu un traitement conservateur.
Les 32 autres (74 %) ont subi une chirurgie, dont 19 sur plusieurs segments osseux. Des complications sont survenues chez 7 animaux (22%), dont des déficits neurologiques postopératoires pour 4. Le risque de ces derniers mérite ainsi d’être évoqué avec les propriétaires avant la décision d’opérer, d’après les auteurs de l’étude.
Avant traitement, des symptômes neurologiques (neurapraxie sciatique, syndrome queue de cheval) étaient observés chez 10 chats (autres que les 4 cas post-chirurgicaux). À moyen terme (6 à 8 semaines), ils n’étaient plus présents chez 5 d’entre eux.
À long terme (6 mois et plus), sur les 14 cas de déficits neurologiques (pré et post-chirurgicaux), les symptômes avaient totalement disparu chez 11 (soit 79 %), et s’étaient améliorés chez 3.
Un chat a toutefois développé des troubles neuromoteurs 3 mois après son traumatisme (traité par des mesures conservatrices), possiblement consécutifs au développement de cals osseux.
8 chats présentent une constipation chronique post traumatique, mais peu fréquente pour la majorité (deux épisodes par an ou moins). Deux sont atteints plus régulièrement.
Aucun cas de mégacôlon n’est rapporté. Mais dans cette étude, aucun chat ne présentait de rétrécissement très important de la symphyse pelvienne (supérieur à 50 %), associé à un risque élevé de constipation et de développement d’un mégacôlon en l’absence de traitement chirurgical.
Seuls 7 chats présentent des boiteries chroniques sur le long terme, dont 3 jugées importantes par leur propriétaire (note de 3 ou 4 sur une échelle de 0 à 5 où 0 représente l’absence de boiterie).
De même, la mobilité de l’animal est conservée ou correcte dans 86 % des cas, avec 6 chats (14 %) dont les capacités de se mouvoir sont jugées fortement affectées.
Ainsi, les fractures du bassin chez le chat « peuvent avoir un excellent pronostic », concluent les auteurs.
28 avril 2025
 4 min
4 min
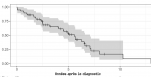
25 avril 2025
 5 min
5 min

24 avril 2025
 4 min
4 min

23 avril 2025
 5 min
5 min
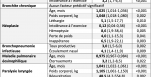
22 avril 2025
 4 min
4 min

18 avril 2025
 6 min
6 min
