29 avril 2025
 5 min
5 min
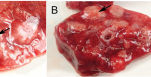
Bienvenue sur LeFil.vet
L'accès au site web nécessite d'être identifié.
Merci de saisir vos identifiants de connexion.
Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.
Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.


12 décembre 2023
Réseaux de cliniques : les décisions du Conseil d'État sont clarifiées. Les établissements ont 3 mois pour se mettre en conformité

Conformément au calendrier fixé, la première étape de la procédure de conciliation entre l'Ordre, les groupes de cliniques et le SNVEL s'est achevée dans les délais prévus : un mois après son démarrage, la clarification des décisions du Conseil d'État se concrétise par la rédaction d'une doctrine d'emploi destinée à faciliter leur mise en œuvre.
Par voie de communiqué, le Syngev (syndicat des groupes d'établissements vétérinaires) a salué une « avancée significative » et a assuré sa mobilisation pour la suite de la procédure. La seconde étape consiste en effet en la mise en conformité des établissements concernés, dans un délai de 3 mois, c'est-à-dire d'ici début mars 2024.
Dans un communiqué accompagnant la diffusion du document vendredi dernier (8 décembre), le ministère de l'Agriculture rappelle brièvement l'historique de la mise en place de cette procédure de conciliation (voir aussi LeFil du 13 octobre), qui a débuté avec le développement en France de grands réseaux de cliniques, dont l'existence n'a jamais été remise en cause. En effet, ces groupes de sociétés d'exercice vétérinaire sont autorisés, mais encadrés par un texte du Code rural (article L.241-17), dont les dispositions visent à conserver l'indépendance professionnelle des vétérinaires en exercice dans ces sociétés, dans un objectif de protection de la santé des animaux et la santé publique. Ces dispositions réglementaires concernent ainsi notamment la répartition du capital de ces sociétés et des droits de vote, et la qualité des vétérinaires praticiens majoritaires, nécessairement en exercice au sein des établissements de soin.
La doctrine comprend 25 points de « conseils et recommandations ». Elle est organisée en trois parties, distinguant les points relatifs à la gouvernance des établissements vétérinaires (18 points), ceux concernant l'exercice effectif des vétérinaires associés majoritaires (3 points) et enfin ceux portant sur les missions de l'Ordre (4 points).
La réglementation prévoit que les vétérinaires en exercice restent les dirigeants majoritaires de leur société : ils détiennent plus de 50 % du capital et des droits de vote. Les points 1 à 18 de la doctrine sont établis pour que ces vétérinaires conservent le contrôle effectif de leur société. Certaines dispositions des statuts ou du mode de fonctionnement des sociétés faisant l'objet d'une procédure de radiation ne permettaient pas de le garantir, selon l'appréciation de l'Ordre, validée par le Conseil d'État.
La doctrine est relativement complète, et écrite dans un langage accessible à des non-juristes. Elle aborde autant les dispositions relatives à la distribution des bénéfices (financiers) entre les actionnaires, qu'aux modes de prise de décisions, les conséquences d'un désaccord, etc.
Mais elle ne livre que des conseils, évoquant souvent par exemple des dispositions « à éviter » ou « à écarter ». Le point 2, par exemple, recommande d'écarter des conventions de vote par lesquelles les vétérinaires associés s'engagent par avance à voter dans le sens de décisions validées par l'investisseur minoritaire : en clair, les associés doivent rester maîtres de leurs choix de vote.
De même, dans le point 3, il est spécifié que les décisions « importantes » de la société (touchant au budget, au recrutement des cadres dirigeants, aux contrats de longue durée…) ne peuvent pas faire l'objet d'une minorité de blocage par l'investisseur.
Les recommandations préservent toutefois aussi les intérêts de l'investisseur minoritaire, lequel doit ainsi pouvoir veiller à l'usage fait de ses investissements, ou donner son accord lors de décisions impactant fortement l'endettement de la société ou son activité.
Les statuts initiaux de certaines sociétés prévoyaient qu'en cas de désaccord avec les préconisations d'une « commission consultative » (ou terme équivalent), dans laquelle l'investisseur a un poids majoritaire, les vétérinaires associés s'engageaient à céder leurs parts (ce qui revient à être d'accord ou devoir partir). La doctrine propose d'exclure ce type d'engagement (point 5).
Ce type de commission, comme les comités ou conseils de surveillance des SAS, qui interviennent dans les décisions stratégiques, n'ont pas vocation à être supprimés, au contraire. Mais il est préconisé que les vétérinaires associés y siègent au moins pour moitié. Il en est de même pour le conseil d'administration d'une SA (point 8).
Dans cette première partie de la doctrine, les points 1 à 8 découlent directement des décisions du Conseil d'État. Ce n'est pas le cas des points 9 à 18, que la mission de conciliation a souhaité toutefois « signaler ». Il serait contreproductif en effet de déposer de nouveaux statuts voués à être de nouveau invalidés par l'Ordre.
Ces 10 points complémentaires abordent les situations de contentieux entre vétérinaires associés et investisseur minoritaire (points 9 et 10), le cas d'une offre de rachat total (100 % du capital), dans lequel une cession des actions ne peut être rendue obligatoire d'avance (point 12), le statut de salarié (qui n'est pas incompatible pour les associés, sous réserve de conserver leur indépendance professionnelle, point 14), les clauses de non-concurrence (qui ne doivent pas être disproportionnées ou abusives, point 17), etc.
Elles complètent aussi les points précédents sur la gouvernance, ajoutant quelques dispositions à écarter, car amenant à une perte du contrôle effectif (des prises de décisions à une double majorité par exemple, point 11), ou au contraire à prévoir, afin que les vétérinaires soient proactifs dans leur gestion, et prennent des décisions éclairées (point 16).
La partie suivante de la doctrine précise les conditions dans lesquelles les vétérinaires associés exercent leur profession dans chaque DPE (domicile professionnel d'exercice). Le Conseil d'État, dans ses décisions de juillet, avait effectivement rappelé que l'objet des sociétés d'exercice est, pour les praticiens, d'exercer en commun. Les associés doivent donc exercer la profession de vétérinaire - au sens de pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire - dans chaque DPE, au moins l'un d'entre eux et au moins à temps partiel.
Les points 19 à 21 précisent ces aspects.
L'« exercice effectif » comprend deux volets (point 19) : une activité de « soignant » (service de clientèle) et – sans obligation – de « coordinateur » (coordination de décisions relevant de l'exercice professionnel). Les échanges à venir entre les parties viendront préciser ces deux volets.
Parmi la mission de ces associés au sein d'un DPE figurent donc la coordination de l'application des dispositions professionnelles, relatives en particulier à la déontologie, aux missions de vétérinaire sanitaire, aux bonnes pratiques professionnelles (point 20). À cette fin, il est proposé que les associés élisent un « comité professionnel » émettant des avis sur tous ces sujets. Des délégations de pouvoir sont possibles dans les sociétés regroupant plusieurs DPE (ce qui est évidemment le cas dans ces réseaux) par les représentants légaux à certains associés : ceux-ci seraient alors en charge de la gestion quotidienne du (ou des) DPE. En pratique, la lecture cette précision est que cette gestion quotidienne est déléguée à l'un des associés (même très minoritaire) mais pas à un salarié ou un collaborateur libéral. Ces derniers peuvent toutefois être dotés d'actions ou d'un prêt d'actions leur permettant de devenir associés – donc de gérer le DPE au quotidien – mais donc d'endosser aussi les obligations et les responsabilités d'associé (point 21).
Ce même point 20 prévoit des garanties dans le contrat de tous les vétérinaires praticiens (associés, salariés comme collaborateurs libéraux) afin qu'ils conservent leur indépendance professionnelle. En cas de difficulté, ils peuvent saisir les associés coordinateurs du DPE ou le comité professionnel, et en dernier recours le Conseil régional de l'Ordre.
Que signifie un travail à temps partiel ? Le point 21 y répond avec précision. Ainsi, travailler à temps partiel dans un DPE consiste à y travailler (au moins) 3 demi-journées par semaine (appréciées toutefois par trimestre). Attention, ce temps minimum est adapté à l'établissement : dans un CHV (ouvert 7 jours sur 7 et 24h/24), il sera nécessairement plus élevé.
Dans son évaluation du travail à temps partiel des associés, l'Ordre évaluera :
Les quatre derniers points (22 à 25) précisent les missions de l'Ordre :
Il est rappelé, à deux reprises dans la doctrine, que le contrôle de ces documents par l'Ordre est une obligation légale. Le secret des affaires ou la confidentialité ne sont pas des arguments recevables pour ne pas s'y plier, de manière complète et transparente (points 18 et 25).
À la lumière de cette doctrine, d'ici début mars, les groupes devront donc avoir régularisé les statuts et les modalités de fonctionnements de leurs sociétés, « en concertation étroite avec leurs associés vétérinaires ». Ce sont en effet les premiers concernés !
En pratique, les nouveaux statuts et les documents extrastatutaires (pacte d'associés ou d'actionnaires) seront transmis aux différents Conseils régionaux de l'Ordre concernés, afin qu'ils en contrôlent au cas par cas la conformité.
Dans son communiqué, le ministère de l'Agriculture prévient qu'il sera vigilant quant au respect des parties dans leurs engagements (notamment celui de suivre la procédure de conciliation) ainsi qu'au bon déroulement de cette mise en conformité.
29 avril 2025
 5 min
5 min
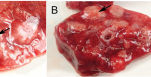
28 avril 2025
 4 min
4 min
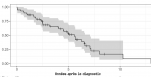
25 avril 2025
 5 min
5 min

24 avril 2025
 4 min
4 min

23 avril 2025
 5 min
5 min
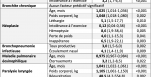
22 avril 2025
 4 min
4 min
